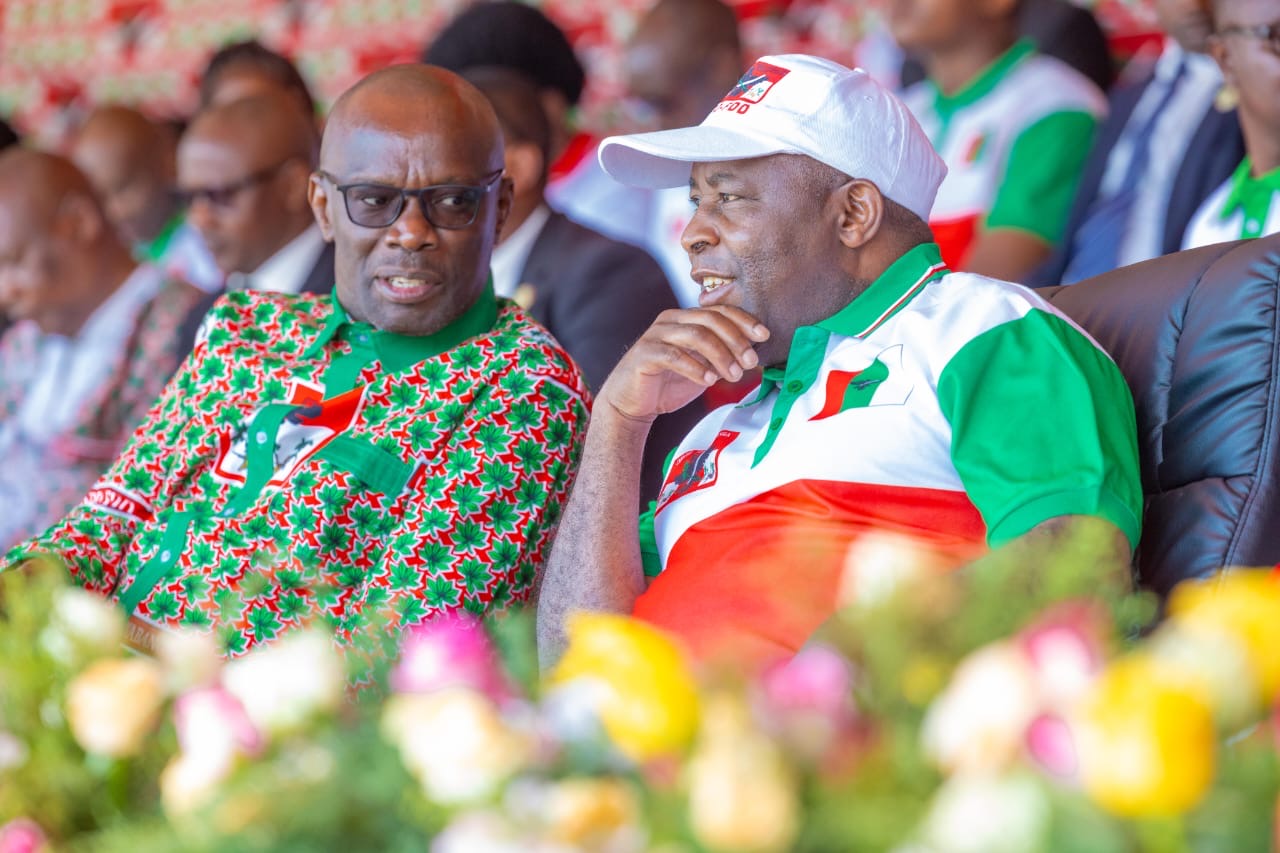Gitega : les vendeuses de rue luttent pour survivre face à la répression policière

SOS Médias Burundi
Dans le tumulte quotidien du centre-ville de Gitega, capitale politique du Burundi, des dizaines de femmes bravent chaque jour la précarité en vendant à la sauvette des fruits, des légumes ou du maïs grillé. Pour ces commerçantes de rue, la survie s’arrache au prix fort : harcèlement policier, saisies brutales de marchandises et violences souvent impunies.
À l’écart des grandes décisions politiques, ces femmes incarnent une économie de la débrouille, nourrissant leurs familles dans un contexte d’insécurité et d’abandon.
« Les policiers viennent souvent nous chasser. On doit fuir, nos fruits tombent à terre, certains sont ramassés par les passants, d’autres embarqués dans des camions vers le commissariat », raconte Georgette Ndayishimiye, mère de deux enfants, qui vend à l’entrée du marché central.
Répression et brutalités
Les descentes policières, régulières, s’accompagnent fréquemment de violences physiques et verbales, à en croire les témoignages recueillis sur le terrain.
« Nous sommes battues, maltraitées, et sans aucune solution de rechange. Nous n’avons pas les moyens de louer des stands au marché », déplore Alice Nshimirimana, veuve de 40 ans et mère de quatre enfants. Elle vend ses produits dans le quartier populaire de Nyamugari, en périphérie de Gitega.
Paradoxalement, bien que leur activité soit considérée comme illégale, ces commerçantes versent chaque jour une taxe communale de 500 francs burundais à des collecteurs municipaux. Un prélèvement qui, pour elles, tient lieu de reconnaissance tacite de leur présence sur la voie publique, même en l’absence de toute protection.
Vivre à crédit, sous la menace
Sans accès au crédit bancaire, la plupart de ces femmes dépendent de dettes contractées chaque matin auprès de grossistes ou de petits prêteurs pour s’approvisionner.
« On achète à crédit le matin, on rembourse le soir. On survit à peine », confie Scholastique Bukuru, originaire de la colline Bwoga, au sud de la ville.
Elle note toutefois un répit temporaire dans les interventions policières, qu’elle relie directement à la période électorale.
« Ce n’est pas par compassion. C’est une stratégie pour nous amadouer et capter nos voix. Mais une fois les élections passées, la répression reprendra de plus belle. »
Associations impuissantes
Des organisations locales, bien qu’engagées, peinent à répondre à l’ampleur du problème faute de ressources suffisantes.
« Ces femmes vivent dans une extrême vulnérabilité, mais les moyens pour les aider à lancer des activités formelles manquent cruellement », déplore Claudette Niyonizigiye, responsable de l’ONG DUSHIREHAMWE, engagée pour l’autonomisation des femmes.
Les autorités campent sur leur position
Côté officiel, les autorités locales assument pleinement les opérations contre le commerce informel. Houssein Butoyi, chef de la zone urbaine de Gitega, justifie ces mesures.
« Ces vendeuses obstruent des points névralgiques comme les boulangeries, les alimentations ou les entrées du marché central. Cela provoque des embouteillages et des accidents. »
Il les exhorte à rejoindre les marchés officiels, seul cadre selon lui compatible avec un commerce régulé et ordonné.
Un combat silencieux dans l’économie de l’ombre
Matraques, confiscations, mépris : les vendeuses de rue de Gitega résistent dans une économie parallèle sans filet de sécurité. Nombre d’entre elles sont veuves, déplacées ou rescapées de crises passées. Le commerce informel est pour elles la dernière bouée de sauvetage.
Mais tant qu’aucune politique inclusive ne viendra reconnaître leur rôle et sécuriser leur travail, elles continueront à avancer dans la marge, tiraillées entre nécessité économique et menaces constantes. Dans l’espoir, peut-être, qu’un jour, leur labeur soit enfin reconnu comme un pilier essentiel de l’économie locale.
________________________________________________
Photo : Des vendeuses de rue installées le long d’une route principale dans la capitale politique Gitega, juillet 2025. © SOS Médias Burundi