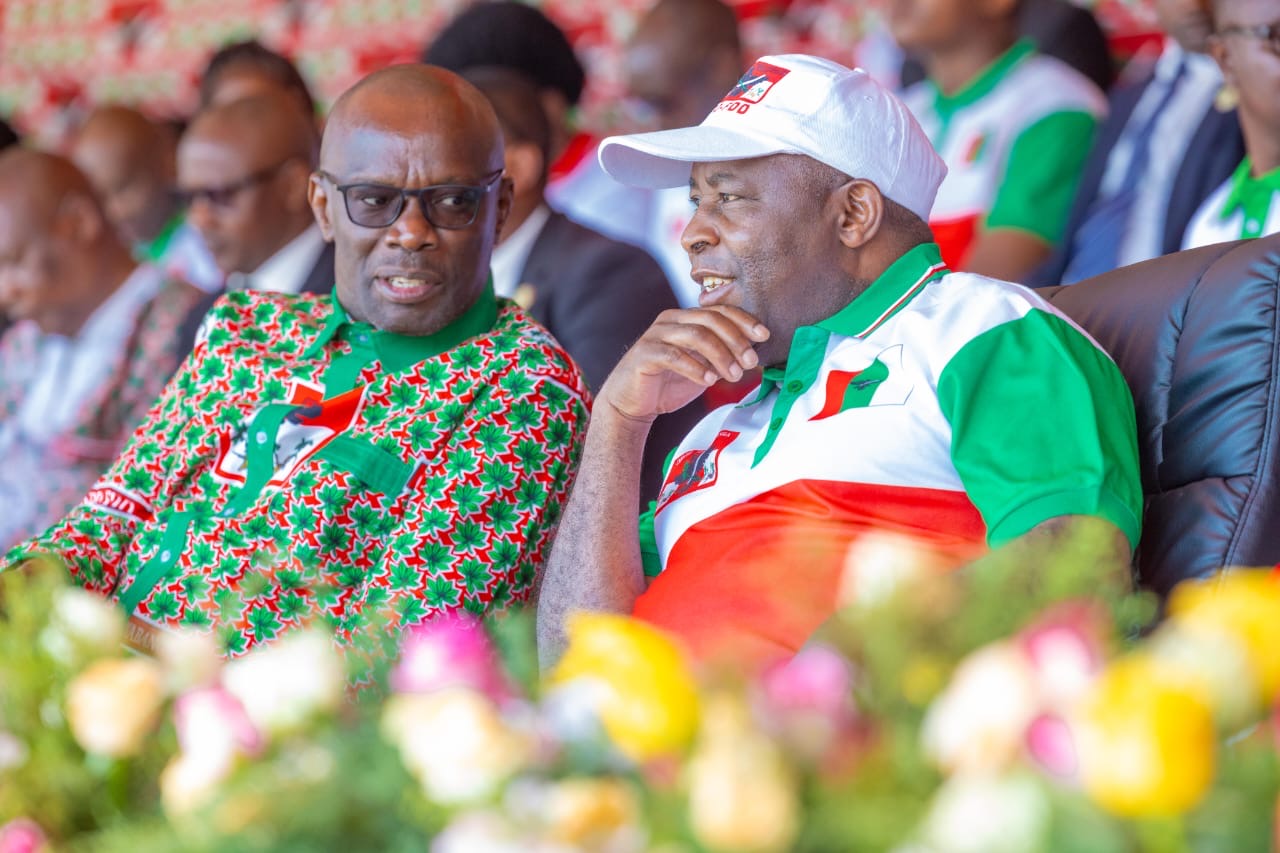Frontières fermées, vies brisées : la détresse grandissante au nord du Burundi

SOS Médias Burundi
La fermeture prolongée de la frontière entre le Burundi et le Rwanda plonge les régions frontalières du nord du pays dans une crise socio-économique sans précédent. À Bugabira, Ntega, Busoni (dans l’ancienne province de Kirundo) et Nyamurenza (ancienne province de Ngozi), les habitants dénoncent un quotidien marqué par la faim, l’insécurité et la misère.
Depuis la rupture des relations diplomatiques entre Gitega et Kigali, les échanges transfrontaliers, autrefois essentiels à la survie de milliers de familles, sont complètement à l’arrêt. Dans ces zones rurales, le petit commerce informel s’est effondré, privant une large partie de la population de sa principale source de revenus.
« Nous transportions des poules pour les vendre au Rwanda et revenions avec des habits de seconde main à revendre sur les marchés locaux. C’est tout notre gagne-pain qui a disparu », déplore une commerçante de Nyamurenza, visiblement abattue.
Ce commerce, en grande partie assuré par des femmes, constituait un pilier de l’économie locale. Sa disparition brutale a entraîné un appauvrissement généralisé, accentuant les vulnérabilités sociales déjà présentes.
Climat d’insécurité et disparitions inquiétantes
Parallèlement à la crise économique, la situation sécuritaire s’est fortement dégradée. En avril 2024, deux habitants de Bugabira ont traversé la frontière en quête d’un emploi journalier au Rwanda. Depuis, aucune trace d’eux. Ces disparitions non élucidées entretiennent un climat de peur et de suspicion vis-à-vis du pays voisin.
« Nous avons peur de traverser, même pour chercher du travail. On ne sait pas ce qui est arrivé à ceux qui sont partis. Le silence des autorités est pesant », témoigne un habitant de Bugabira.
Des familles sans ressources, des enfants hors de l’école
Au-delà du commerce, nombreux étaient les Burundais qui se rendaient régulièrement au Rwanda pour travailler dans les champs, attirés par des salaires journaliers parfois trois fois supérieurs à ceux versés au Burundi. Le franc rwandais, dont la valeur est estimée à près de cinq fois celle du franc burundais (FBu), renforçait l’attractivité de ces emplois. La fermeture de la frontière a ainsi privé ces travailleurs d’une source vitale de revenus.
Les conséquences sont dramatiques pour de nombreuses familles. À Busoni, une mère de six enfants confie :
« Nous n’avons plus rien. Certains jours, nos enfants ne mangent qu’une seule fois. On ne sait plus comment survivre. »
Face à cette pauvreté extrême, l’abandon scolaire se généralise. Une ONG allemande, Welthungerhilfe, soutient encore les cantines dans certaines écoles, mais ses efforts peinent à compenser l’ampleur des besoins.
Un appel à la réouverture de la frontière
Dans cette situation désespérée, les populations locales appellent les autorités burundaises à revoir leur position diplomatique.
« Nous ne faisons pas de politique. Nous voulons juste travailler pour vivre. Qu’on nous rouvre la frontière », implore un commerçant de Ntega.
Dans l’attente d’un réchauffement des relations entre Gitega et Kigali, les habitants des communes frontalières tentent de survivre tant bien que mal. Mais l’incertitude demeure, et avec elle, la souffrance.
Une crise diplomatique qui perdure
Les relations entre le Burundi et le Rwanda sont tendues depuis plusieurs années. En janvier 2024, Gitega a ordonné la fermeture des frontières terrestres, accusant Kigali de soutenir des groupes armés hostiles au gouvernement burundais, notamment le RED-Tabara — un mouvement rebelle basé en République démocratique du Congo, soupçonné de bénéficier de complicités au Rwanda.
Le président Évariste Ndayishimiye a déclaré à plusieurs reprises que « la paix du Burundi ne peut être garantie tant que certains pays voisins hébergent des ennemis du peuple burundais ». Sans citer explicitement le Rwanda, ses propos ne laissent guère de doute sur la cible de ses accusations.
Lors de rencontres publiques — notamment à Kinshasa avec des jeunes et plus tard avec des diplomates accrédités à Bujumbura — le chef de l’État est allé plus loin, accusant son homologue rwandais Paul Kagame d’être « le déstabilisateur de la sous-région » et de vouloir « attaquer son pays comme il a envahi le Congo ». Des accusations qu’il a également réitérées dans plusieurs entretiens avec des médias étrangers.
De son côté, le Rwanda a toujours nié ces allégations, appelant au dialogue et à une normalisation des relations bilatérales. Toutefois, les efforts de médiation régionale, notamment ceux engagés par la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC), sont restés jusqu’ici sans effet : les postes-frontières restent fermés, et les espoirs des populations locales, suspendus à des décisions diplomatiques qui tardent à venir.
________________________________________________
Photo : Des vendeuses ambulantes à la frontière de Ruhwa, entre le Burundi et le Rwanda, le 11 janvier 2024. © SOS Médias Burundi