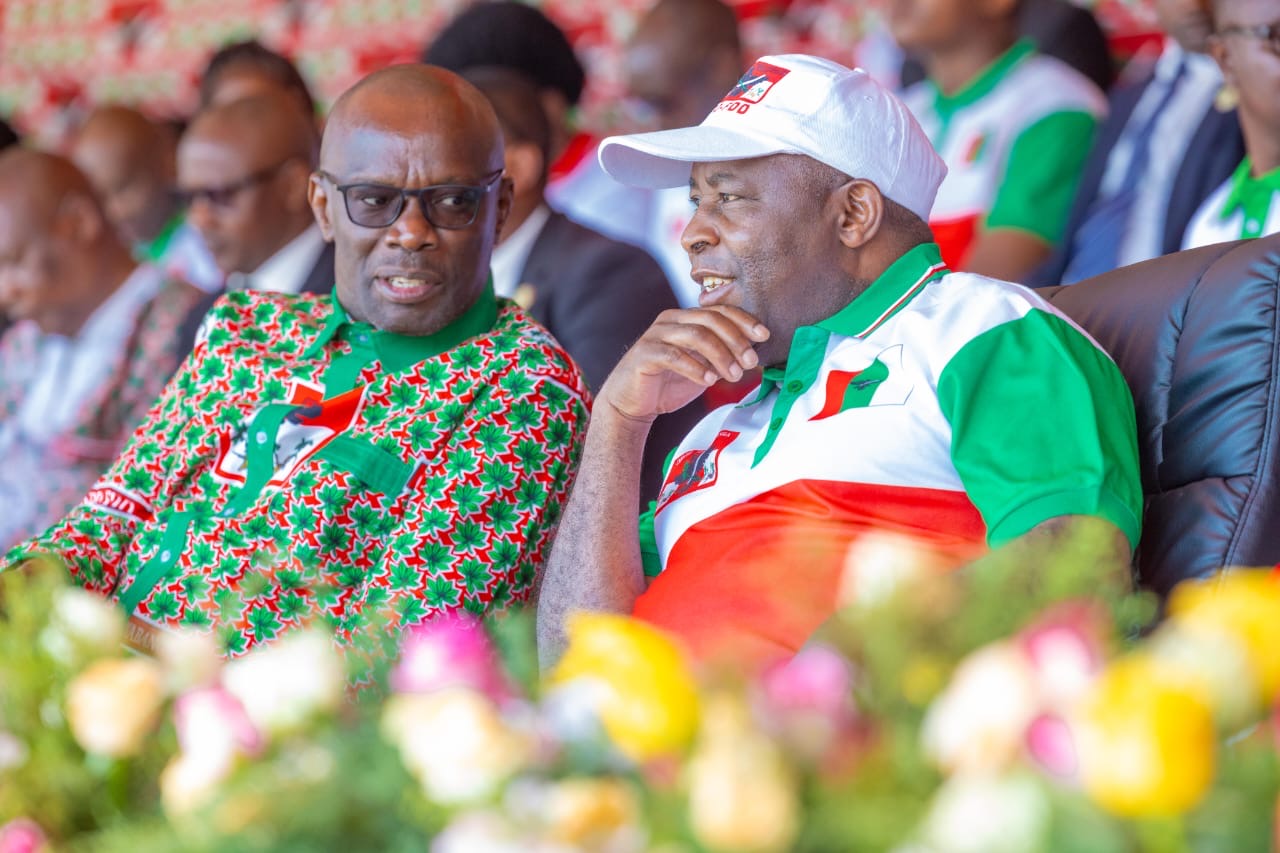Kinama : l’alcool ravage la jeunesse et mine les familles du camp de réfugiés

SOS Médias Burundi
Au camp de réfugiés de Kinama, situé dans la commune de Gasorwe, dans la province de Muyinga (nord-est du Burundi), l’alcoolisme prend une tournure alarmante. Pour de nombreux jeunes réfugiés congolais, l’alcool est devenu un refuge face à l’ennui, la pauvreté et l’absence de perspectives. Mais cette échappatoire a un coût : elle nourrit la violence domestique et contribue à l’effritement du tissu social du camp.
Depuis plusieurs mois, la consommation d’alcool, notamment chez les jeunes, ne cesse d’augmenter. Les boissons sont vendues aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du camp, de manière plus ou moins discrète. La plupart sont produites localement, dans des conditions artisanales. Parmi elles, le Kiboko, fabriqué par la compagnie Akeza, figure en tête des plus consommées. Il est souvent associé à d’autres alcools puissants comme Hozagara, Susuruka ou encore Urwarwa Rw’Iwacu.
« Je bois pour oublier »
Faradja, un réfugié congolais arrivé au Burundi en 2008 alors qu’il n’avait que 10 ans, témoigne de sa dépendance croissante à l’alcool :
« Je bois parce que je n’ai rien à faire. Je n’ai pas de travail. J’ai essayé d’étudier ici au camp, mais j’ai abandonné. J’ai vu mes camarades boire, alors moi aussi j’ai commencé. L’alcool m’aide à oublier. Quand je suis ivre, je ne pense plus au stress du camp. »
Comme beaucoup d’autres jeunes, Faradja noie ses journées dans l’ivresse, parfois dès le matin, seul ou en groupe. Cette habitude devient peu à peu une routine bien ancrée, révélatrice d’un mal-être généralisé.
Une crise qui déstructure les familles
Mais le phénomène ne se limite pas à la jeunesse. L’alcoolisme touche également de nombreux adultes, avec des conséquences dramatiques sur la vie familiale. Clémentine, mère de trois enfants, raconte sa descente aux enfers :
« Mon mari ne travaille pas. Il passe ses journées dans les bars du camp. Le peu d’assistance que nous recevons via le PAM, il en vend une partie pour s’acheter de l’alcool. Le soir, il rentre ivre, me frappe sans raison et dit des choses honteuses devant les enfants. Il mélange parfois Kiboko avec Hozagara, ce qui le rend encore plus agressif. »
Le PAM – le Programme alimentaire mondial – est censé aider les familles les plus vulnérables. Mais pour certaines, comme celle de Clémentine, cette aide se volatilise dans l’alcool.
« Mes enfants ont peur de lui. Parfois, il vomit là où il dort. Ce n’est pas une vie », lâche-t-elle, impuissante.
Un avenir bouché
Au-delà des cas individuels, c’est l’absence d’activités socio-éducatives et de perspectives professionnelles qui favorise cette spirale de dépendance et de désespoir. Le camp manque cruellement d’initiatives pour occuper et encadrer la jeunesse. Plusieurs réfugiés, ainsi que des acteurs humanitaires, appellent à la mise en place de projets concrets pour offrir des alternatives à l’alcool et redonner de l’espoir à ceux qui vivent depuis trop longtemps dans l’attente.
Créé il y a plus de 20 ans, le camp de Kinama accueille aujourd’hui plus de 8 000 réfugiés congolais. Si rien n’est fait pour freiner l’expansion de l’alcoolisme, c’est toute une génération qui risque de se perdre dans l’oubli.
________________________________________________
Photo : Dans une cuisine communautaire du camp de Kinama (nord-est du Burundi), des réfugiés congolais s’organisent pour préparer les repas quotidiens. © SOS Médias Burundi