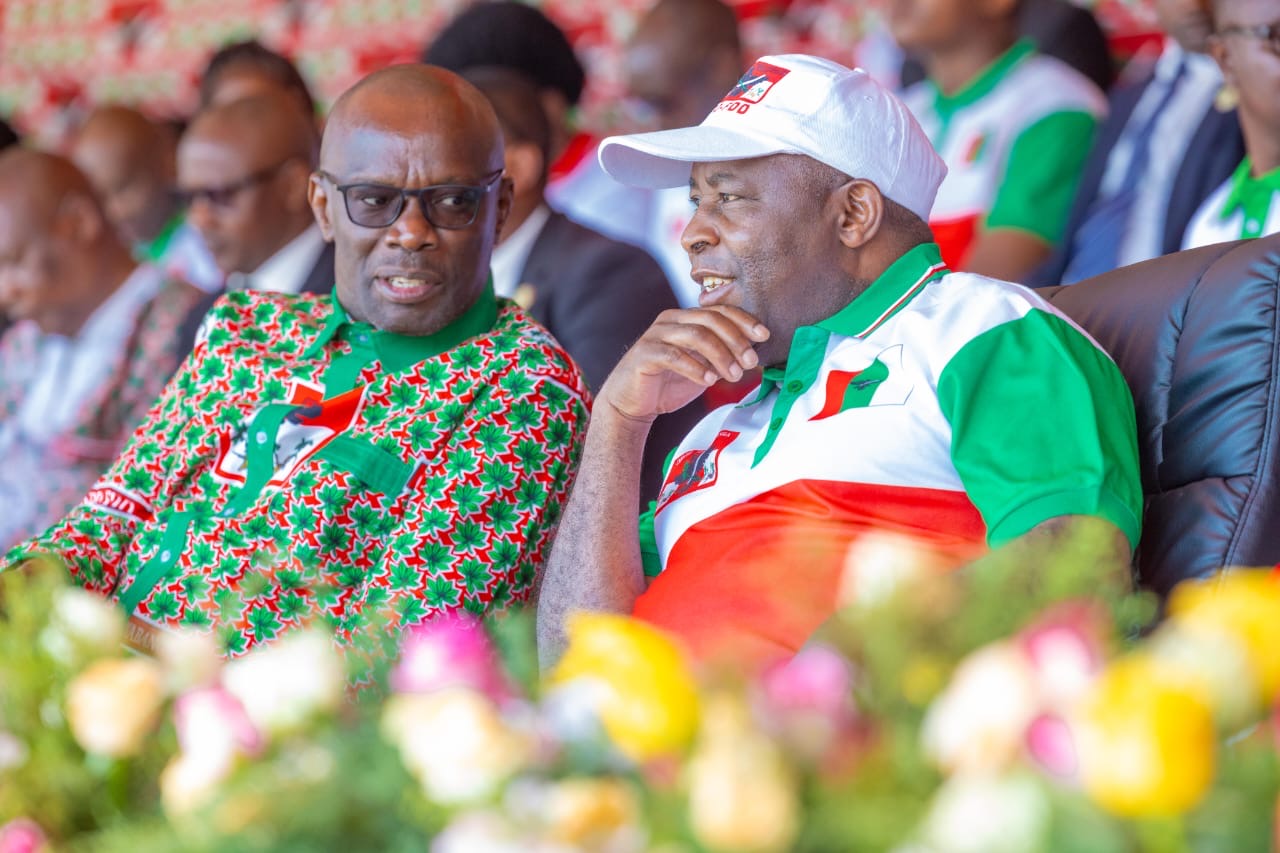Classement RSF 2025 : le Burundi poursuit sa chute dans un paysage médiatique africain de plus en plus répressif

Le nouveau classement de Reporters sans frontières confirme une tendance préoccupante : le Burundi perd 17 places et se retrouve au 125e rang mondial. Un recul qui illustre la dégradation continue de la liberté de la presse dans le pays et sur l’ensemble du continent.
Le Burundi enregistre un inquiétant recul de 17 places dans le Classement mondial 2025 de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières (RSF), se positionnant désormais au 125e rang sur 180 pays. Ce déclassement illustre une réalité préoccupante : le climat dans lequel opèrent les journalistes burundais devient chaque année plus hostile, alors que l’ensemble du continent africain semble plongé dans une spirale régressive en matière de liberté de la presse.
Avec un score de 45,44, le pays se classe désormais parmi les États africains les plus en retrait sur le plan des garanties accordées aux médias. Cette dégringolade intervient en dépit de quelques signaux d’ouverture timides envoyés par le président Évariste Ndayishimiye, insuffisants pour inverser la tendance.
Deux femmes journalistes ont récemment été condamnées à des peines de prison pour « atteinte à l’intégrité du territoire national », l’une d’elles étant toujours derrière les barreaux. Le paysage médiatique burundais, autrefois considéré comme l’un des plus dynamiques d’Afrique de l’Est, peine à se relever depuis la tentative de coup d’État de 2015. De nombreux médias contraints à l’exil poursuivent leurs activités depuis l’étranger, tandis que ceux restés sur le sol burundais opèrent dans un climat de surveillance et de pression constantes.
Le rapport 2025 de RSF met en lumière une dégradation généralisée sur le continent : près de 80 % des pays africains ont vu leur score économique se détériorer, notamment en raison de la concentration des médias entre les mains de figures proches du pouvoir ou d’acteurs économiques politisés. Cette dépendance accrue aux financements publics compromet lourdement l’indépendance éditoriale. Des cas similaires sont observés au Nigeria (122e), au Togo (121e) et au Bénin (92e).
Dans plusieurs pays, des décisions administratives ont provoqué un affaiblissement brutal des rédactions. Au Burkina Faso (105e, -19 places) ou en Guinée (103e), de nombreuses structures médiatiques ont été contraintes de réduire leur activité, entraînant pertes d’emplois et baisses drastiques de revenus. À l’est de la République démocratique du Congo (133e, -10 places), l’insécurité persistante a poussé plusieurs journalistes à l’exil ou à la fermeture de leurs organes de presse.
La carte de la liberté de la presse dressée par RSF continue de s’assombrir : sept pays africains figurent désormais dans la catégorie rouge dite “très grave”. Parmi eux, l’Ouganda (143e), l’Éthiopie (145e), le Rwanda (146e) et le Burundi (125e), malgré la libération de la journaliste Floriane Irangabiye en 2024, qui n’a pas suffi à infléchir la tendance générale.
Sur le plan mondial, la Norvège conserve sa première place avec un score de 92,31, en légère progression par rapport à l’année précédente (91,89). À l’inverse, l’Érythrée ferme la marche avec seulement 11,32 points, en chute libre par rapport aux 16,64 obtenus en 2024. Ces extrêmes soulignent l’écart grandissant entre les pays où la liberté de la presse est solidement protégée et ceux où elle est constamment menacée.
________________________________________________________
Photo : Des salariés du groupe de presse Iwacu rassemblés dans la cour intérieure devant le portrait de Jean Bigirimana qui a disparu le 22 juillet 2016, le 23 juillet 2024 à Bujumbura © SOS Médias Burundi