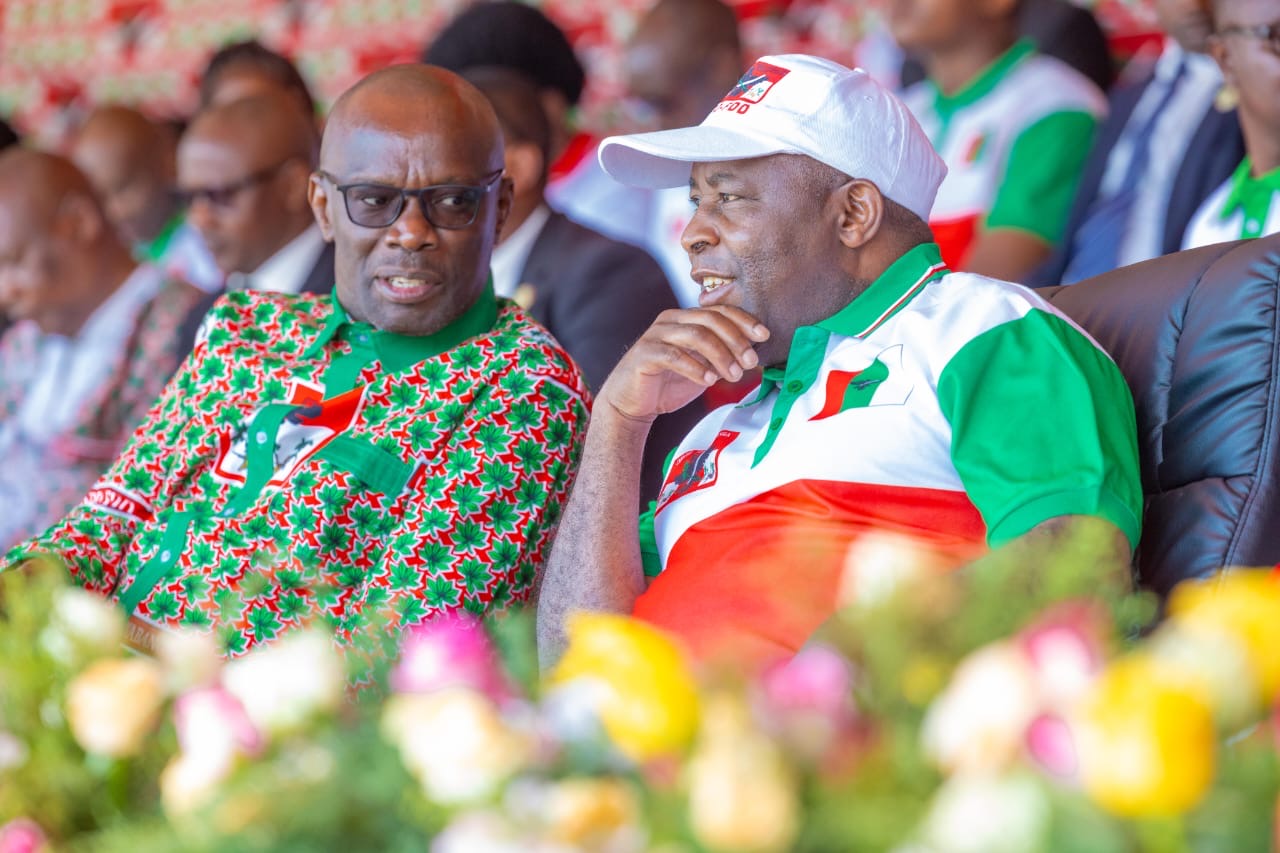Kinama : des femmes burundaises témoignent de leurs relations solidaires avec les réfugiés

Autour du camp de réfugiés de Kinama, situé dans la commune de Gasorwe, au nord-est du Burundi, des femmes burundaises ont su transformer une situation difficile en opportunité. Ces dernières, qui vivent aux côtés des réfugiés en provenance de la République démocratique du Congo (RDC), ont trouvé des moyens pour subvenir aux besoins de leurs familles tout en développant une solidarité avec leurs voisins réfugiés.
Le camp de Kinama, créé en 2004, abrite aujourd’hui plus de 7.000 réfugiés. Malgré un contexte de plus en plus difficile, marqué par la réduction de l’aide alimentaire, des femmes burundaises ont réussi à créer des opportunités économiques au sein de ce camp, notamment en proposant des services de lessivage des vêtements des réfugiés. Lors de la journée dédiée aux droits des femmes, plusieurs d’entre elles ont partagé leurs expériences et les bénéfices de cette collaboration avec SOS Médias Burundi.
Une source de revenus essentielle pour les familles burundaises
Parmi les témoignages recueillis, celui de Jusline, une mère de cinq enfants, a particulièrement attiré l’attention. À 40 ans, elle subvient seule aux besoins de ses enfants depuis l’abandon de son mari. Pour faire face à cette situation, Jusline a trouvé une source de revenus en lavant les vêtements des réfugiés. Cette activité lui permet de gagner environ 100.000 francs burundais par mois, un montant qui assure la stabilité financière de sa famille.
« Ce travail est un véritable soutien. Avec ces 100.000 francs, je peux acheter de la nourriture, payer les fournitures scolaires de mes enfants et même épargner dans une association d’épargne et de crédit », explique-t-elle.
« Quand mon mari est parti, je ne savais pas comment m’en sortir. Mais grâce à ce travail, je peux offrir à mes enfants une vie digne. »
Un travail qui change des vies
Lucie, 38 ans, vit à proximité du camp et travaille depuis cinq ans comme lessiveuse pour les réfugiés. Grâce à son travail, elle gagne environ 40.000 francs burundais chaque semaine. Cette source de revenus lui a permis d’acquérir une parcelle de terrain pour construire une maison et offrir à ses enfants un foyer stable.
« Ce travail m’a permis de devenir autonome », témoigne-t-elle. « Aujourd’hui, je peux répondre aux besoins de ma famille sans trop d’angoisse. Je suis fière de pouvoir investir dans l’avenir de mes enfants et d’assurer leur éducation et leur santé. »
Des solutions alternatives pour une vie meilleure
Anisette, une autre femme qui a trouvé refuge dans cette activité, témoigne des bénéfices concrets qu’elle a obtenus grâce à ses revenus. Mère célibataire de deux enfants, elle a pu acheter deux chèvres, dont le fumier enrichit ses champs agricoles, garantissant ainsi une meilleure production et une alimentation plus stable pour ses enfants.
« Les chèvres sont d’une grande aide. Elles me permettent d’avoir une meilleure production agricole, ce qui garantit à mes enfants une alimentation plus stable », explique-t-elle avec un sourire plein d’espoir. « Ce n’est pas facile, mais je me bats chaque jour pour eux. »
Une situation qui se complique avec la réduction de l’aide
Cependant, malgré ces réussites, les femmes burundaises autour du camp de Kinama se trouvent confrontées à de nouveaux défis. La réduction de l’aide alimentaire aux réfugiés a provoqué une pénurie de ressources et une diminution des opportunités de travail pour les hôtes.
« Depuis cette baisse, il est plus difficile de trouver du travail. Les réfugiés reçoivent moins de rations et ne peuvent plus nous employer comme avant », déplore Anisette.
Ce phénomène a compliqué la vie des femmes qui, pour continuer à subvenir aux besoins de leurs familles, doivent redoubler d’efforts pour s’adapter à cette nouvelle réalité précaire.
Une relation de solidarité et d’entraide
Le camp de Kinama, bien que confronté à des difficultés, reste une véritable source d’opportunités pour la communauté locale. De nombreuses familles burundaises, et particulièrement les femmes, ont su tisser des liens de solidarité avec les réfugiés. Outre les services de lessivage, d’autres activités génératrices de revenus ont vu le jour, telles que des petites boutiques, la vente de produits alimentaires et l’artisanat.
Loin d’être un simple lieu d’accueil, le camp de Kinama a, en effet, permis à de nombreuses femmes burundaises de gagner en autonomie, tout en maintenant une relation harmonieuse avec les réfugiés. Ces femmes font face à des défis quotidiens, mais leur résilience et leur solidarité montrent que, même dans des situations difficiles, il est possible de transformer l’adversité en force.
Une évolution du camp
Au-delà de l’aspect économique, la présence du camp a permis à la population hôte de se diversifier dans ses activités commerciales et agricoles. Cependant, avec les récentes réductions d’aide alimentaire et les difficultés économiques croissantes, il reste à espérer que des solutions durables seront mises en place pour garantir à la fois la sécurité des réfugiés et des familles burundaises.
Alors que le camp de Kinama continue d’évoluer et de grandir, il est essentiel de maintenir l’esprit de solidarité qui a fait la force de ces femmes burundaises. Elles sont un exemple de courage et de détermination dans un environnement marqué par des défis constants.
________________________________________________________________
Photo : des vendeuses de fruits non loin du camp de Kinama dans le nord-est du Burundi, novembre 2024 © SOS Médias Burundi