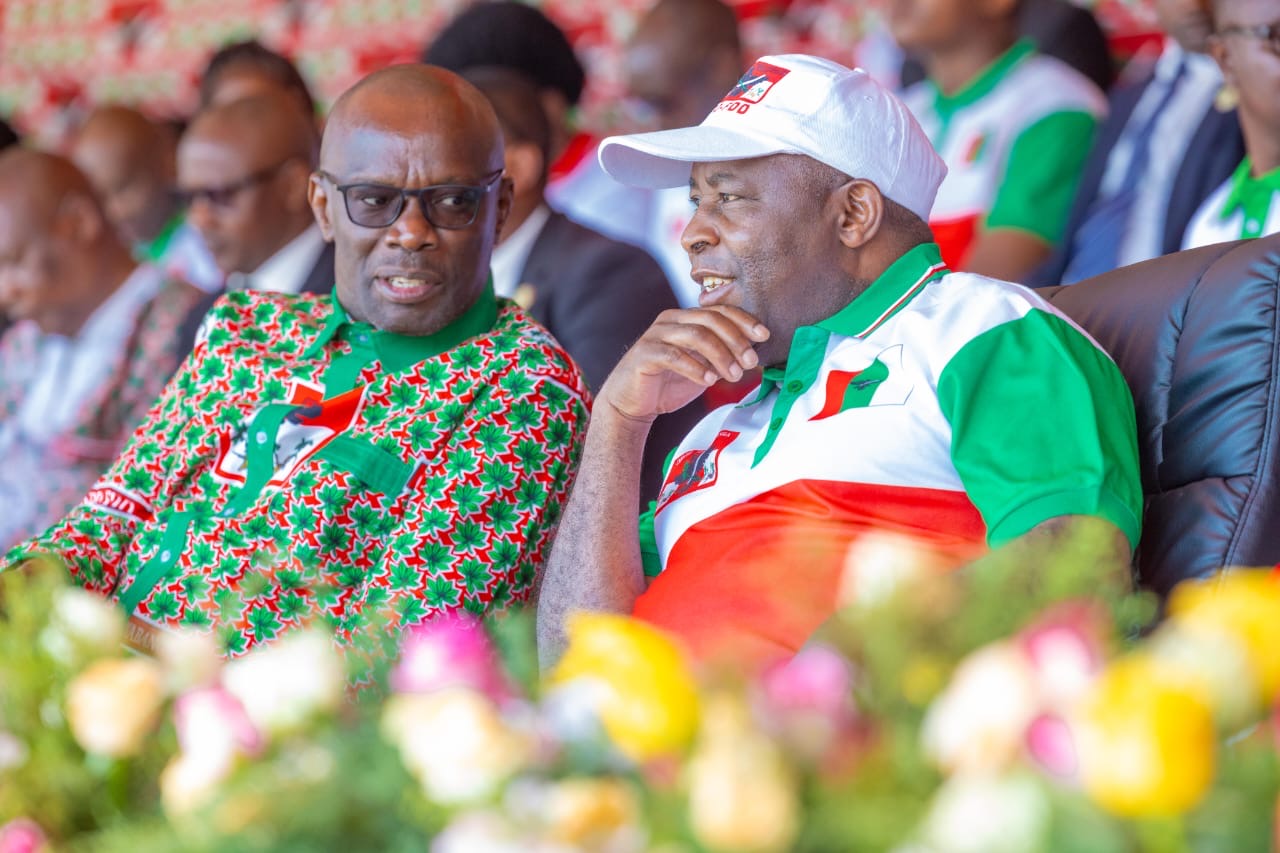Rwanda : découverte du virus mortel Marburg

Le ministère rwandais de la santé publique a confirmé vendredi ,la découverte du virus mortel Marburg dans certaines structures sanitaires.La population est appelée à être vigilante tout en respectant strictement les mesures d’hygiène. (SOS Médias Burundi)
Le communiqué du ministère rwandais de la santé ne précise pas le nombre de cas, encore moins les établissements sanitaires concernés.
Certaines informations circulant sur les réseaux sociaux font état de décès, notamment parmi le personnel médical. Mais selon les autorités sanitaires, aucun décès n’a été signalé à ce jour.
Le Centre biomédical du Rwanda (RBC) a déclaré avoir élaboré des directives complètes pour la détection et la prise en charge des fièvres hémorragiques virales (FHV) en réponse à la fréquence accrue des maladies émergentes et réémergentes en Afrique. Les voisins du Rwanda sont confrontés à de multiples épidémies. Aujourd’hui, les lignes directrices visent à doter les travailleurs de la santé des connaissances, des compétences et des pratiques nécessaires pour prévenir en toute sécurité, s’y préparer et y répondre dans les établissements de santé et dans la communauté, selon ce centre.
Une évaluation nationale des risques réalisée l’année dernière au Rwanda a classé Marburg comme « modérée » dans un pays où les risques sont accrus en raison de sa proximité avec des pays connaissant des épidémies de FHV, parmi lesquels le Burundi et la RD Congo, où la pandémie de variole du singe se propage à une vitesse très élevée, plus que dans d’autres pays africains, selon l’OMS ( Organisation mondiale pour la santé).
En 2022, le pays des mille collines a été le théâtre d’une importante épidémie de fièvre de la vallée du Rift qui touche à la fois les humains et les animaux. 22 cas humains sur 125 et 516 cas sur 1, 339 animaux sont morts.
C’est quoi le virus mortel Marburg (OMS)?
Le virus Marburg est l’agent causal de la maladie à virus Marburg, dont le taux de létalité peut atteindre 88 %, même si une bonne prise en charge des patients permet de fortement baisser ce taux. La maladie à virus Marburg a été détectée pour la première fois en 1967, lors de flambées survenues simultanément à Marburg et à Francfort (Allemagne), ainsi qu’à Belgrade (Serbie).
Les virus Marburg et Ebola appartiennent tous deux à la famille des filoviridés (filovirus). Bien qu’elles soient provoquées par deux virus différents, les deux maladies sont similaires sur le plan clinique. Elles sont toutes les deux rares et ont la capacité de provoquer des flambées épidémiques avec un taux de létalité élevé.
La maladie a été reconnue pour la première fois à l’occasion de deux grandes flambées épidémiques survenues simultanément en 1967 en Allemagne (à Marburg et Francfort) et en Serbie (à Belgrade). Elles étaient liées à des travaux de laboratoire sur des singes verts africains (Cercopithecus aethiops) importés d’Ouganda. Par la suite, on a signalé des flambées et des cas sporadiques en Angola, en République démocratique du Congo, au Kenya, en Afrique du Sud (chez une personne ayant voyagé peu avant au Zimbabwe) et en Ouganda. En 2008, deux cas indépendants ont été notifiés chez des voyageurs ayant visité une grotte abritant des colonies de roussettes (Rousettus) en Ouganda.
Transmission
À l’origine, l’infection chez l’homme résulte d’une exposition prolongée dans des mines ou des grottes abritant des colonies de roussettes.
La transmission est avant tout interhumaine et résulte de contacts directs (par une éraflure ou à travers les muqueuses) avec du sang, des sécrétions, des organes ou des liquides biologiques de personnes infectées, ou avec des surfaces et des matériaux (par ex. draps ou vêtements) contaminés par ces liquides.
Il est arrivé fréquemment que des agents de santé soient infectés en s’occupant de cas suspects ou confirmés de maladie à virus Marburg. Ces infections ont eu lieu lors de contacts rapprochés avec les patients sans appliquer correctement les précautions de lutte anti-infectieuse. La transmission par du matériel d’injection contaminé ou par des piqûres accidentelles s’accompagne d’une forme plus grave de la maladie, d’une dégradation rapide de l’état physique et éventuellement d’une mortalité plus élevée.
Les cérémonies d’inhumation au cours desquelles il y a un contact direct avec le corps du défunt peuvent aussi contribuer à propager la maladie à virus Marburg.
Les personnes infectées restent contagieuses tant que le virus est présent dans leur sang.
Symptômes de la maladie à virus Marburg
La période d’incubation (le délai entre l’infection et l’apparition des symptômes) va de 2 à 21 jours.

La maladie provoquée par le virus Marburg s’installe brutalement, avec une fièvre élevée, de fortes céphalées et un malaise grave. Les myalgies et les douleurs sont des manifestations courantes. Une diarrhée aqueuse profuse, des douleurs et des crampes abdominales, des nausées et des vomissements peuvent apparaître au troisième jour. La diarrhée peut persister une semaine. On décrit souvent les patients à ce stade comme ayant l’aspect de « fantômes », avec des yeux profondément enfoncés, un visage inexpressif et une léthargie extrême. Lors de la flambée européenne en 1967, on a observé chez la plupart des malades une éruption cutanée non prurigineuse entre le deuxième et le septième jour après l’apparition des symptômes.
De nombreux patients développent des manifestations hémorragiques sévères entre le cinquième et le septième jour et les cas mortels présentent en général des hémorragies sous une forme ou une autre, avec le plus souvent de multiples localisations. L’observation de sang frais dans les vomissures ou les selles s’accompagne souvent de saignements du nez, des gencives et du vagin. Les saignements spontanés aux points de ponction veineuse (pour administrer des liquides ou prélever des échantillons sanguins) peuvent être particulièrement problématiques. Pendant la phase intense de la maladie, on observe une forte fièvre. L’atteinte du système nerveux central peut entraîner des états confusionnels, de l’irritabilité et de l’agressivité. L’orchite (inflammation d’un ou des deux testicules) a parfois été rapportée au stade tardif de la maladie (15 jours).
Dans les cas mortels, le décès intervient 8 à 9 jours après l’apparition des symptômes et il est en général précédé d’une perte de sang abondante et d’un choc.
Diagnostic
Il peut être difficile, sur la base des symptômes cliniques, de distinguer la maladie à virus Marburg d’autres pathologies comme le paludisme, la fièvre typhoïde, la shigellose, le choléra et d’autres fièvres virales hémorragiques.
Traitement et vaccin
Il n’existe actuellement pas de vaccin ni de traitement antirétroviral approuvé pour la maladie à virus Marburg. Cependant, des soins de soutien – réhydratation par voie orale ou intraveineuse – et le traitement de certains symptômes spécifiques améliorent la survie des patients.
Des anticorps monoclonaux sont en cours de développement et des antirétroviraux, comme le Remdesivir et le Favipiravir qui ont été utilisés dans le cadre d’études cliniques portant sur la maladie à virus Ebola, pourraient également être testés pour la maladie à virus Marburg ou faire l’objet d’un usage compassionnel ou d’un accès élargi.
En mai 2020, l’Agence européenne du médicament a délivré une autorisation de commercialisation pour les vaccins Zabdeno (Ad26.ZEBOV) et Mvabea (MVA-BN-Filo) contre la maladie à virus Ebola. Le vaccin Mvabea contient un virus connu sous le nom de Vaccinia Ankara Bavarian Nordic, qui a été modifié pour produire quatre protéines à partir de l’espèce Ebolavirus Zaïre et trois autres virus du même groupe (filoviridae). Il est possible que ce vaccin puisse apporter une protection contre la maladie à virus Marburg, mais son efficacité théorique n’a pas été démontrée dans le cadre d’essais cliniques.
_______________________________________________
Photo : un agent de santé dans une campagne de vaccination contre le Mpox au Rwanda, septembre 2024, DR